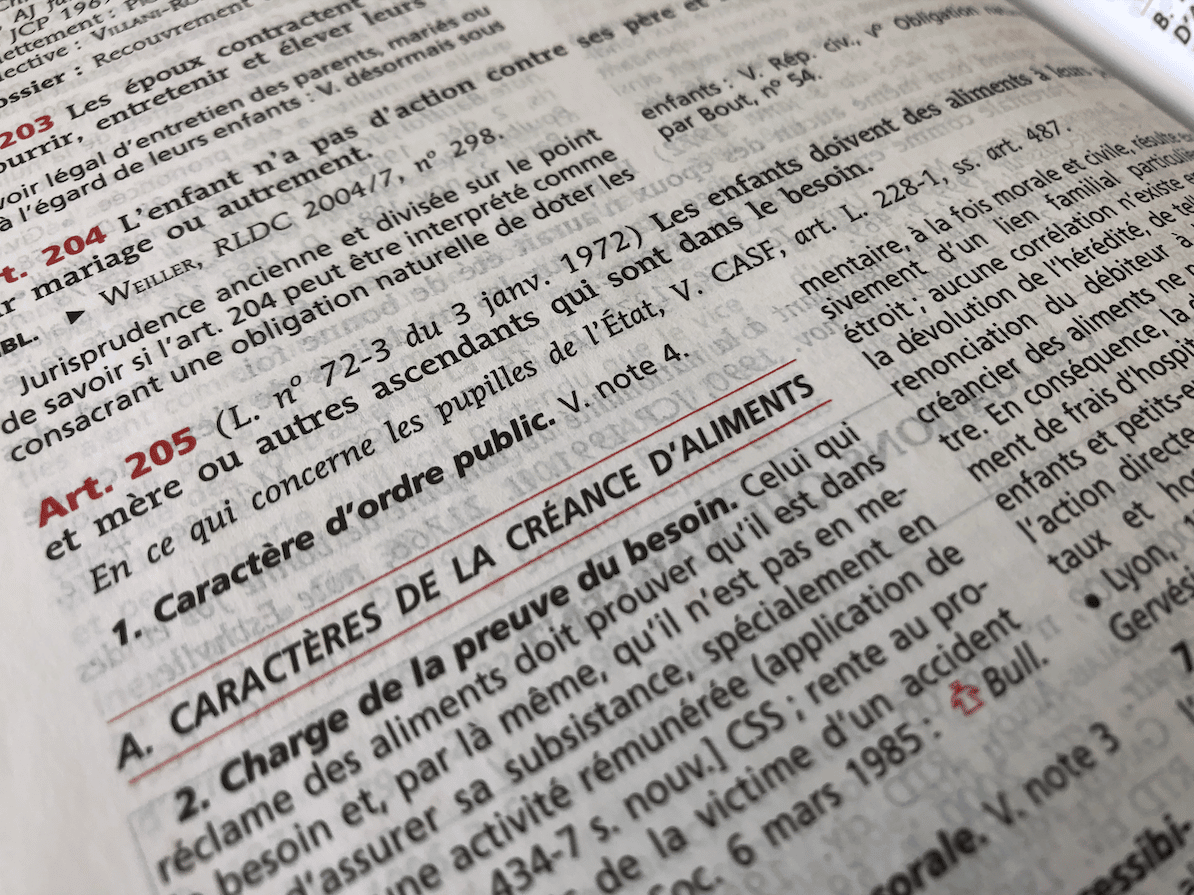Ecrit par Laurent Maljan
Des élections, du candidat, et de l’enfant de choeur
Il existe, lors d’une élection, un moment délicieux qui se situe à quelques jours du scrutin.
Vous êtes parti de zéro, mais vous avez travaillé, vous avez serré des mains, et vous vous rendez compte que vous avez gagné des voix, et que le sort des urnes pourrait vous être favorable.


Et plus les jours passent, vous rapprochant du terme, et plus vos partisans, dont les rangs ont grossi, vous confirment la tendance ; « il va lui faire très mal ».
Vous avancez alors sûr de vous ; vous en êtes certain, votre adversaire doute, et vous goûtez à ce moment magique, et vous avez raison. Car « l’euphorie du candidat », comme l’amour, ne dure pas.
Le lundi 21 mars 2011, je me réveillai avec « la gueule de bois du perdant », qui est l’exact contraire de « l’euphorie du candidat ». J’avais préparé deux discours que j’avais glissés dans ma poche. Un discours où il était question de l’avenir du canton, où je disais que je tiendrais les promesses du candidat, et, un papier, où j’avais jeté quelques notes ; où j’évoquais la lente érosion des voix de mon camp, un contexte national difficile, et les handicaps d’une première candidature.
Mais lorsque le journaliste m’interrogea, je ne trouvai pas le fameux papier, et je ne réussis à balbutier que quelques onomatopées. J’étais un peu assommé, à la recherche d’un peu d’ordre dans mes idées. Je n’étais qu’un homme ; avec sa force, lorsqu’il s’était agi de se battre pour la conquête des urnes, et beaucoup de fragilité dans la défaite ; j’étais fatigué.
Je ne trouvai pas les mots ; pas ceux que je cherchais.
Je pensai un instant à la veille ; à l’attente des résultats, et à cette petite salle de bar où nous nous réunîmes, silencieux, cherchant des raisons à la défaite. Je vis mes amis tristes, et une terrible responsabilité s’empara de ma personne. J’avais pu incarner un espoir, à un moment donné, mais je n’étais ce soir-là que le symbole de la défaite, et c’était très lourd à porter.
J’eus une pensée pour Yvette. Elle m’avait accompagné dans ce marathon, auquel je n’étais pas préparé, comme une fée, une bonne étoile.
Elle avait suivi les pérégrinations d’un apprenti candidat. D’abord avec intérêt, ce fut l’époque du lancement de la campagne électorale ; avec perplexité, lors de mes premières prestations, ou lorsqu’elle corrigeait le projet de discours que je devais adresser à la presse, et avec enthousiasme lors des derniers rassemblements, et en particulier à celui de Limerzel. Ce soir-là, lorsque j’achevai de parler, dans cette salle de Limerzel, dans le pays qui est le mien, je me dirigeai vers elle. Je pris alors ses mains ; je les serrai quelques minutes, et les larmes me montèrent aux yeux ; je savais que c’était fini.
Etaient-ce des larmes de fatigue, du dépit de savoir que malgré tous ces efforts la défaite était acquise ? Etaient-ce les larmes de rage du compétiteur qui ne montera pas sur le podium ? Je ne sais pas.
Le lendemain, veille de l’élection, je me rendis au centre d’art à Caden. A l’écoute des vidéos, retraçant le travail en milieu rural, avec en filigrane ces deux éléments fondamentaux que sont la terre et l’eau, je fus rasséréné. Je me dirigeai ensuite vers Limerzel, et je m’arrêtai au cimetière, sur la tombe du grand-père André.
Je vis le calvaire. Je jetai un coup d’œil au christ sur sa croix. C’est à ses pieds que je fus attaché par nos ennemis ; je veux parler des « gars de la grée ». Il y avait à Limerzel deux clans rivaux, nés de l’imagination d’écoliers et aussi du lieu de sa domiciliation. Soit vous habitiez dans le bourg et vous faisiez partie ipso facto des « gars du bourg », soit vous habitiez sur la grée, la commune est très vallonnée, et vous deveniez l’ennemi héréditaire des premiers. Cet antagonisme se doublait d’une querelle bien connue des manuels d’histoire de France. Nos adversaires fréquentaient l’école du diable, nous étions les petits soldats de cette confrérie lucrative et non déclarée, des enfants de chœur. Il pouvait arriver, en été, qu’une troisième bande se mêle à cet affrontement fraternel, je veux parler des « parigots », qui se situaient, à nos yeux, sur l’échelle d’évaluation de la valeur combattante à la hauteur de soldats d’opérette. Nous avions vite fait de les enrôler contre quelques bonbons que nous achetions à la boulangerie.
Ces combats étaient épiques, et parfois dangereux. En été, nous nous envoyions des pommes que nous piquions au bout de baguettes flexibles, et en hiver des boules de pins, qui pouvaient faire mal. C’est pourquoi nous mettions des casques, très hétéroclites. Cela allait du casque de moto aux casques allemands, vestiges du passé, au sommet desquels était soudée parfois une gouttière qui rappelait leur fonction d’après guerre, vidanger les véhicules. Avec, de temps à autre, la présence d’un casque de « tommy » qui ressemblait à une assiette.
Ces combats, que le moindre incident, par exemple un mot de travers lors d’une partie de billes, ravivait, pouvaient être également l’exutoire de préadolescents intéressés par la sœur…d’un parigot. Ils se prolongeaient également sur les terrains de foot Ball où les parties, l’honneur était en jeu, tournaient au pugilat.
Les deux équipes avaient élaboré une symbolique, dont l’existence d’un trésor était la pierre angulaire, et qui devint, au fil du temps le but à atteindre : récupérer le trésor des ennemis. C’était très présomptueux puisqu’il n’y avait aucun butin mais c’était là, à notre petite échelle, la transposition de cette vaste cour de récréation que sont les sociétés humaines où le but du jeu n’est finalement que de s’approprier les richesses des autres; et c’est ce qui explique le traitement qui me fut réservé sur la croix.
En effet, j’eus la malchance, un après midi, me trouvant près de l’école, de rencontrer sur ma route, l’équipe au grand complet des gars de la grée. Leur chef qui me dépassait de deux têtes, et tous ses soldats, énervés et revanchards, trop heureux de tomber sur l’un de leurs adversaires. Je fus alors attaché manu militari au pied de la croix, comme un malfrat au Golgotha, autour de laquelle mes ennemis dansèrent une sorte de danse guerrière, à la manière des indiens dans les westerns de John Ford.
C’est une rude épreuve pour un enfant de chœur que d’être attaché à son outil de travail.
Ce sont ces heures d’attente qui forgèrent ma suspicion à l’égard du religieux. C’est vrai, il n’y avait que quelques centimètres, entre les doigts de pied de mon employeur, et ma tête. Il eut été si facile de faire un miracle. L’eau n’avait-elle pas été changée en vin, Sainte Geneviève n’avait-elle pas arrêtée les huns ? J’étais pourtant le pur produit d’une culture qui reposait sur la religion. La réflexion, les actions, quelles qu’elles fussent, relevaient du divin. Il fallait tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de parler, marquer du signe de la croix le pain avant de le partager, et nous étions assurés d’une vie dans l’au delà. C’était d’un fatalisme déconcertant mais nous étions heureux. Le monde pouvait s’écrouler, imploser même comme lors des deux conflits majeurs du vingtième siècle, Dieu reconnaitrait les siens. Ce ne fut pas le cas, j’attendis jusqu’au soir qu’une bonne âme, l’instituteur du diable, un comble, veuille bien me délivrer.
Le temps était rythmé par ces grands moments de la vie religieuse. Les rameaux avec cette odeur si reconnaissable du romarin et du laurier. La fête Dieu qui me mettait en colère car je ne supportais pas qu’un homme, le recteur, quand bien même fut il le représentant sur terre du grand patron, puisse souiller ce chemin constitué de pétales de fleurs, de sciure, de mousse, qui pour moi était une œuvre d’art. Les missions qui se tenaient dans la grande salle du restaurant. Il s’agissait de ventes de chapelets, et d’objets religieux avec surtout des vies de saints dont je me délectais.
La vie de la famille était régie par les prêtres. Par mes grands oncles, Ernest le missionnaire qui se trouvait à cette époque aux Antilles où il est enterré ; par le bon Alfred qui, disait mon grand-père était planqué à l’évêché, et par René qui vaticinait dans les cures du Val de Loire. Ils apparaissaient, de manière sporadique, pendant leurs « vacances », profitant allègrement du respect qu’ils imposaient. Ils avaient table ouverte, se tenant près du maître de maison, à la bonne place; bénissaient le repas, prenaient des nouvelles de chacun, prodiguaient leurs conseils. Ils s’enquerraient des études des petits derniers, évoquaient les fameux cours en latin, l’histoire de l’art, plutôt le quattrocento, tous les cours dispensés par le grand séminaire, ce temple de la connaissance; à l’évocation duquel ma grand-mère levait les yeux au ciel. Pour ce qui me concerne, ce n’était pas gagné. J’étais le garnement, jamais assis, sur la photo des repas de communion, des mariages et autres réunions de famille, présidés par mon grand-père.
Ce vieux gredin avait compté plus qu’un autre dans la décision de me présenter à cette élection, et j’avais décidé, maladroit dans la prière, de lui dire, avec des mots simples, ce que ses mots à lui avaient forgé dans le cœur d’un gamin devenu un homme. Je le vis encore une fois au volant de la « chichinette », la deux chevaux la plus lente des véhicules terrestres à moteur mais aussi la plus célèbre, au moins à Limerzel ; et je l’entendis me répéter, alors que j’étais engoncé dans le siège, sans suspension, du passager : « Ich bin funf jahre alter gefangener in deutschland gewesen » (j’ai été 5 ans prisonnier en Allemagne), voulant me montrer sa maitrise de la langue de Goethe, qu’il avait apprise dans des circonstances très particulières, c’était en stalag, dans un monde que je ne connaitrai pas, précisant , avec cet air de sérieux qui m’impressionnait, que la guerre était la pire des choses, que les hommes avaient pu se haïr, s’entretuer, mais qu’il convenait, néanmoins, de s’ouvrir au monde afin d’éviter cette catastrophe qui marqua sa vie comme elle marquerait l’existence des générations à venir.
Je me vis alors ouvrir la vitre, que l’on rabattait vers le haut, et mettre la tête au dehors, et me griser des couleurs, du jaune du colza en fleurs, du vert des pâturages ; je m’entendis même fredonner avec lui cette chanson que le vieil homme entonnait lors des fameux repas de famille, « Elle s’appelle Françoise… » et goûter au bonheur.
Dans les jours qui suivirent, j’éprouvai la sensation du rien. Vous êtes tout. Vous êtes l’homme sur les affiches, les gens que vous rencontrez vous sourient ; et l’instant d’après, je veux parler du dépouillement, vous ne trouvez que silence et mépris. C’est très difficile de passer du tout au rien.
Vous vous remettez aussi au travail. Au début, c’est dur mais il faut être cohérent, c’est ce que vous avez proposé à vos électeurs; de travailler.
De temps à autre, vous apercevez une affiche en lambeaux, et vous comprenez mieux la fragilité de votre existence. Vous êtes beau, souriant, avec ce visage de conquérant, propre au candidat, et quelques jours après, il vous manque un œil, puis une déchirure plus marquée vous arrache une oreille. C’est terrible de partir en lambeaux, ou de se retrouver avec une moustache ou une paire de lunettes dessinées à la va vite.

C’est terrible mais aussi amusant. Nous ne sommes que des images, et nous n’existons que dans le regard d’autrui ; il suffit de vous reporter à la soirée de la défaite. Quelques jours après, vous avez retrouvé un peu de vitalité. Vous n’existez toujours pas puisque vous avez perdu. Vous êtes un exilé social, une sorte de pénitent ou de lépreux mis en quarantaine, pour vos ex amis de la politique un confetti dans les oubliettes de l’histoire.
Et les jours passent, et vos forces reviennent, et aussi, parfois, l’envie du combat, mais vous savez très bien, vous l’avez lu dans les yeux de vos proches, et avec un peu de recul, qu’une page s’est durablement tournée. Vous pensez à ces folles journées, à votre exaltation dans la difficulté mais aussi à votre égoïsme, et vous prenez alors votre crayon et vous commencez à écrire : « Il existe, lors d’une élection… »

Ecrit par Laurent Maljan
Cette histoire vous a plu?
Les livres de Laurent Maljan vous plairont aussi !
Derniers articles
Chasse
Un petit village breton
Un petit village bretonCe fut la découverte la plus importante de ma nouvelle vie de pensionnaire à Saint-François Xavier, dans le Morbihan. Cela se passait en 1971. Alors que j’ouvrais la première page d’une bande dessinée retraçant les aventures de deux gaulois,...
Faites honneur à vos bécasses!
Faites honneur à vos bécassesVous en conviendrez, il n’y a rien de plus moche que d’oublier une bécasse au congélateur. Passé six mois, elle sera à jeter. C’est une hérésie, un crime ! Un gibier ne peut finir que dans une assiette. Tout chasseur, digne de ce nom, doit...
Ne laissez pas trainer vos chiens ou…
Ne laissez pas trainer vos chiens ou…Oui ! Vraiment ! Ca la fout mal ! Vous connaissez « Sheila » ! La chienne de Jean-Claude le chasseur, mon voisin ! Le basset aux babines botoxées (le chien pas Jean-Claude)! La malheureuse avait disparu. Vous savez l’amour de...

Suivez-moi
Newsletter
Inscrivez-vous à la newsletter
Inscrivez-vous à la newsletter pour être au courant des derniers articles avant tout le monde ! Laurent Maljan vous réserve quelques surprises dans les mois à venir...
Suivez-moi